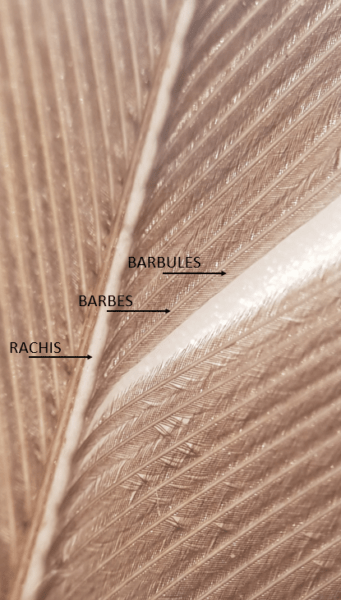Le 20 septembre 2024, un Grèbe esclavon de première année est observé au poste 7 en pleine effervescence de marée haute. Il porte un plumage de mue pas toujours évident à interpréter, mais le bec court bien droit et la tête plate permettent d’exclure le Grèbe à cou noir, dont trois oiseaux sont encore présents au poste 2. Il est le plus “gros” – 400 grammes – des trois petits grèbes.
Cette espèce niche en Scandinavie, en Russie et sur les bords de la Baltique, avec quelques petites populations isolées en Islande et en Ecosse. Il est peu abondant en hivernage en France, avec seulement 300 à 500 individus, principalement sur le littoral Manche Atlantique, et reste peu fréquent en Picardie tant sur le littoral qu’à l’intérieur des terres. L’espèce est en limite sud de l’aire habituelle d’hivernage. Et avec le changement climatique et une baisse de certaines populations nicheuses en Europe, elle se fait de plus rare en France.
Sur le Parc depuis 50 ans, le Grèbe esclavon ne fut observé que 14 fois pour un total de 20 oiseaux différents. La dernière observation date de 2017 (et l’avant-dernière de 2007 !) avec un oiseau qui sera observé du 3 mars jusqu’au 10 mai, permettant alors de profiter de son superbe plumage nuptial. Un individu avait déjà été observé en plumage nuptial à une date tardive sur le Parc du 17 au 24 mai 2007.
Merci aux photographes Olivier Margollé et Didier Plouchard, et aux très nombreux visiteurs à marée haute au poste 7, qui ont pu profiter de cette surprise nordique !
Texte : Philippe Carruette / Illustrations : Olivier Margollé, Didier Plouchard