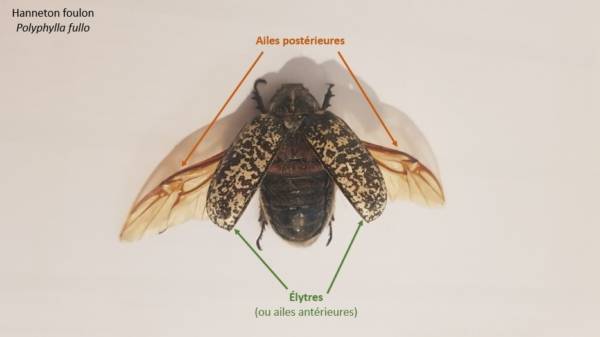Le mois dernier, nous vous invitions à partir en expédition dans l’univers des petites bêtes de la Réserve de la baie de Somme.
Little Five, épisode n°1 : Le Lion du Marquenterre
Après avoir découvert la vie princière du Lion du Marquenterre, allons en quête du second grand prédateur composant notre Little Five : un être aux mœurs secrètes, dont les taches diffuses se mêlent aux ombres inquiétantes des ramures sauvages… Attention, tremblez devant… le Léopard !
Allez, quelques génuflexions en guise d’échauffement, et c’est parti pour notre safari au ras du sol !
La panthère des pluies
Une pluie fine et tiède ruisselle paresseusement le long du tronc d’un peuplier, parcourant son écorce crevassée jusqu’à une cavité mystérieuse, creusée au fil des ans. Elle recèle en son sein une minuscule mare temporaire, appelée dendrotelme, dont les rives obscures sont colorées de lichens orange, bleus, verts. C’est là, lovée au bord de cette piscine naturelle, qu’elle somnole indolemment, parfaitement dissimulée dans l’intimité de son arbre : voici la Limace léopard (Limax maximus).
Malgré ce que laisserait supposer son nom latin, elle n’est pas l’espèce la plus imposante de sa famille – les Limacidae – car une cousine la surpasse de quelques millimètres : la bien-nommée Grande Limace (Limax cinereoniger). Toutefois, avec ses 13 centimètres de longueur, c’est indéniablement une géante au royaume des minuscules. Certains chercheurs (et non chasseurs) de mollusques – appelés malacologues dans le jargon scientifique – auraient aperçu des individus mesurant jusqu’à 20 centimètres !
Le corps, gris cendré à brun pâle, possède un manteau (ou bouclier) marbré de taches noires, à l’arrière duquel se situe le pneumostome, cet orifice par lequel elle respire. La longue queue est elle aussi ornée de marbrures sombres formant deux ou trois bandes longitudinales plus ou moins discontinues, dont les motifs, variables en nombre et en intensité, sont propres à chaque individu – tout comme le sont nos empreintes digitales. Quant à la sole de reptation, cette partie inférieure du pied permettant à la limace de ramper sur toute sorte de surface, elle est uniformément crème. Sur sa tête, quatre tentacules rougeâtres rétractiles lui permettent de voir le monde…
En chasse
Alors que la lumière du jour décline, voici notre panthère qui s’étire, et sort nonchalamment sa frimousse jusqu’alors cachée sous le bouclier protecteur. Calmement, sans se presser, elle se met en marche – ou plutôt, en glisse – quittant le creux humide de son arbre. Pour avancer, elle sécrète un mucus incolore qui laissera une trace à peine brillante derrière elle, indice subtile de son escapade nocturne.
Notre héroïne a faim. Pas difficile, elle se contenterait de toutes sortes de mets : mousses desséchées, bois mort, plantes abîmées… Mais ce soir, ce ne sont pas ces champignons en décomposition qui l’intéressent, ni ces fleurs fanées tombées au sol. Non, aujourd’hui, elle veut troquer son régime détritivore pour un délicieux plat de viande !
D’ailleurs, elle a déjà repéré son repas, là-bas sur le chemin. La voici qui se met en chasse, tentacules tendues en avant, et poursuit sa proie à une vitesse de 15 centimètres par minute ! Plus que quelques longueurs et elle sera sur elle. Mais… Quoi ?! Serait-elle en train de traquer un congénère ?! Eh oui : notre panthère ne se refuse pas un petit plaisir cannibale de temps à autre…
Étreinte funambule
Revivifiée par ce repas gargantuesque, la panthère repue peut se consacrer à cet autre besoin qui l’anime : trouver l’amour, et assurer sa descendance. Désormais âgée d’un an et demi, il est grand temps pour elle de se reproduire. D’autant qu’elle n’aura pas de multiples occasions de procréer : une fois cette année, en plein cœur de l’été ; une fois l’année prochaine, à la fin du printemps. Elle sera alors presque arrivée au terme de sa vie, et mourra l’hiver venu… Alors il ne faut pas traîner !
Comme la majorité des gastéropodes, notre léopard est hermaphrodite : il possède à la fois les organes génitaux mâles et femelles. Mais pas question de s’autoféconder ! Non, il doit trouver un partenaire. Et cela tombe bien, car en voici un qui s’avance là-bas, sublime dans sa parure mouchetée.
Les deux amants s’approchent l’un de l’autre, et commence alors une parade nuptiale qui scellera leur union : s’effleurant d’abord chastement, ils se mettent ensuite à tourner en rond, formant un cercle parfait, puis se courtisent délicatement en se léchant mutuellement des heures durant, semblant échanger leurs voeux dans ce long baiser…
Le couple amoureux escalade ensuite le tronc d’un arbre. Arrivé sur une branche suffisamment haute, il se laisse soudain flotter dans le vide par un épais fil de mucus arrimé à la végétation ; c’est là, dans ce moment suspendu entre ciel et terre, qu’ils entrelacent leurs corps, formant une torsade sensuelle. Puis les deux partenaires sortent chacun leur pénis blanc bleuté de leur gonopore – l’orifice génital situé sur le côté de la tête – et les enroulent l’un l’autre. Alors, dans le secret de cette étreinte, les léopards échangent leurs spermatozoïdes…
Pour en voir davantage, cliquez ici…
Une fois fécondés, chacun doit reprendre son chemin dans le silence de cette nuit d’été : l’un remonte le fil de mucus, tandis que l’autre le redescend. Jamais plus ils ne se reverront…
Notre panthère se met ensuite en quête d’un lieu tranquille où elle pondra dans le sol une grappe compacte de dizaines à centaines d’œufs, petites billes gélatineuses transparentes mesurant à peine 5 millimètres. Dans trois semaines environ, une nouvelle génération de léopards viendra au monde… s’ils survivent à leurs multiples prédateurs : hérissons, crapauds, musaraignes, merles, sangliers… Tous feraient volontiers un festin de panthère.
Dans la communauté des dendrotelmes
Déjà la lueur de l’aube inonde les prairies du Marquenterre. Il est l’heure pour notre panthère devenue mère de regagner son abri. Très routinière, elle est mue par un fort instinct de retour, et retrouve ainsi chaque jour la cachette où elle a ses habitudes.
Non grégaire, elle préfère mener sa barque en solitaire… Enfin, presque ! Car c’est tout un peuple miniature qui partage son trou d’arbre, en quête de la fraîcheur de ce microhabitat : cloportes, escargots, iules… La vie grouille dans cette oasis protectrice, une vie que l’on n’imagine même pas.
Alors quand vous vous promènerez à proximité d’un cours d’eau, en forêt, dans un jardin ou même en ville, jetez un coup d’œil discret dans les crevasses des vieux arbres. Peut-être y trouverez-vous notre léopard en train de sommeiller…
*******
Pour découvrir la suite de ce “Little Five” made in Marquenterre, rendez-vous le mois prochain… ou bien directement au Parc, le 11 juillet, pour une sortie spéciale en quête de petites bêtes !
Texte et illustrations : Cécile Carbonnier